Indignez vous ! La parole est à Oliver Adam, écrivain
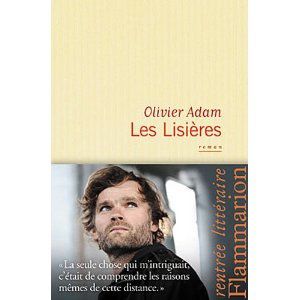
"Pierre Bourdieu est mort il y a dix ans. Et à la manière qu’on a eue en France d’enfouir sa pensée, d’en relativiser la portée (ce qui dit assez bien son caractère encombrant, sa lucidité si brûlante qu’on préfère la soustraire à la vue) ou de ne pas véritablement s’en saisir (et à ce jeu, politiques et écrivains ont été aussi experts les uns que les autres), je me dis parfois qu’il est mort de nombreuses fois depuis.
Je me souviens encore du jour de sa disparition, et de l’émotion qu’elle a provoquée en moi, comparable à celle qui m’a étreint à la mort de Barbara, Pialat ou Bashung – et ces quatre, auxquels il faudrait ajouter Carver, donnent une idée assez précise de mon Panthéon personnel. Pourtant, en ce qui me concerne, Pierre Bourdieu est toujours vivant. Son influence a été si déterminante qu’elle fonde aujourd’hui encore une bonne partie de ma manière de voir, de penser le monde, et in fine de l’écrire.
Découverte
Je l’ai découvert à l’âge de dix-neuf ans, sur la recommandation d’un professeur de sociologie qui s’amusait de me voir trimbaler mes livres de Modiano et mes disques de Léonard Cohen dans un établissement où la plupart de mes semblables se baladaient Les Échos sous le bras, rêvaient de diriger des ressources humaines, de contrôler la gestion ou de manipuler des produits financiers les plus toxiques possible. Cette lecture a été une véritable révélation.
J’étais étudiant dans une école sise dans le XVIe arrondissement de Paris, qui n’avait d’Université que le nom, où l’on entrait uniquement sur dossier, et depuis quelques mois je commençais à comprendre que cette sélection était essentiellement sociale.
Quelles qu’en soient les raisons (dossiers écartés quand ils venaient de lycées localisés en zone sensible ou de peu flatteuse réputation, corrélation entre succès scolaire et classe sociale, ignorance dans les milieux modestes de l’existence de ces filières et des moyens d’y accéder, incrédulité quant à la possibilité de les intégrer…), les faits étaient là: je venais de banlieue sud, des classes moyennes (du moins le croyais-je, avant de comprendre que la plupart des étudiants qui s’asseyaient à mes côtés, pourtant fils et filles de cadres supérieurs, de dirigeants d’entreprises, de professions libérales vivant dans les arrondissements chic de Paris, les banlieues favorisées du 92 ou du 78, s’y rangeaient également, mon pedigree me plaçant plutôt, à leurs yeux, au sein des catégories populaires.
Moi qui, au beau milieu des banlieues pavillonnaires et HLM où j’avais grandi, muni d’un père employé de banque et d’une mère au foyer, d’un pavillon individuel et de vacances au camping une fois par an, m’étais longtemps cru «privilégié», je découvris alors que ma vision du monde demeurait parcellaire, qu’il existait une autre réalité, bien plus dorée que celle entrevue dans les allées des résidences Kaufmann and Broad où se planquaient les élites suburbaines, et que la frontière séparant dominants et dominés ne se situait pas exactement là où je l’avais cru.), et j’étais l’un des seuls.
Ce n’était là qu’un minuscule aspect des rouages implacables de la machine à reproduire et du déterminisme social, mais c’était précisément celui qui prenait corps devant moi et me hantait, tant j’avais de difficultés à m’adapter aux us et coutumes de mes camarades, tant l’assurance que leur donnait l’argent et le fait d’avoir grandi dans un monde «protégé» me sautait aux yeux, et me donnait le sentiment d’appartenir, comme l’écrit Annie Ernaux, à une autre race. Mon entrée dans le monde des études supérieures m’a ainsi déniaisé. Et la lecture de Bourdieu, qui lui est concomitante, a achevé de me déciller les yeux.
Éclairage
Bourdieu est venu m’éclairer sur moi-même, le parcours que j’amorçais, celui de mes parents, de ma famille, de mes copains d’enfance, que j’avais perdus de vue au rythme classique de l’élimination: déscolarisation ou CAP pour les garçons des cités, BEP ou bac pro pour les filles, bac ou BTS pour ceux des lotissements, université au centre ville, classes prépa dans les résidences plus huppées.
Il m’a renseigné sur mes sentiments mêmes, mes empêchements, mon malaise, mes difficultés relationnelles, les conflits qui me rongeaient, honte et trahison, imposture et fierté, complexe et rejet, tout ça mêlé, mieux que ne l’aurait fait aucun psy – et écrivant ces mots me revient l’image de Bourdieu au Val Fourré, expliquant à ses interlocuteurs qu’il connaissait mieux leur réalité et ses mécanismes qu’eux-mêmes, qui pourtant les vivaient: grand moment de vérité inconfortable et salutaire, grande affirmation du pouvoir supérieur de la réflexion et de l’analyse rationnelle, qui fut en elle-même une leçon, un manifeste.

Si Bourdieu m’a aidé à mieux me comprendre, à mieux comprendre le monde d’où je venais et celui où je pénétrais, s’il m’a éclairé sur ma position de transfuge, il m’a surtout aidé, en les mettant à nu, en les identifiant et en explicitant la manière dont elles s’organisaient, à me jouer des barrières qui me séparaient des sphères auxquelles je me destinais sans en venir.
On caricature souvent le travail de Bourdieu en en soulignant le caractère fataliste: le poids des déterminismes y est tel que tout combat serait perdu d’avance. Les mécanismes de la domination et de la reproduction sociale sont si performants et si bien entretenus par ceux qui en sont les bénéficiaires et ne peuvent garder leur position qu’aux frais de ceux qui les subissent, que rien ne peut les mettre en défaut – et même pas l’école, pourtant le seul ascenseur à disposition.
Il y a sans doute une part de vérité dans ce constat – et je vérifie chaque jour combien, pour ceux qui viennent de plus bas que moi, les forces en présence demeurent si déséquilibrées qu’à quelques exceptions près rien ne peut renverser l’ordre établi. Je demeure néanmoins persuadé que sans cet éclairage, sans avoir pris conscience de l’ampleur de la tâche, de ses contours et de sa réalité, je n’aurais jamais eu l’obstination, la persévérance qu’il a fallu pour aller au bout de mon projet: devenir romancier, quand tout, partout, me disait que ce n’était pas pour moi, que ce genre d’activité, comme tant d’autres choses, tant d’autres vies, n’était pas «pour nous», mais réservée «aux autres», aux hautes sphères, aux fils de.
Le champ littéraire
Cela peut sembler aujourd’hui «aller de soi» mais à l’époque, du haut de mes dix-neuf ans, lire sous sa plume qu’en sus de ce qu’on nomme de manière floue le talent (qui comme le goût serait spontané, un don, une disposition individuelle, conception bien pratique tant elle permet d’en effacer la composante sociale, si encombrante au yeux de ceux qui les possèdent, aimeraient ne les devoir qu’à leurs mérites personnels et en rester les seuls détenteurs – ah ! les délices de la distinction, du bon goût, de l’entre-soi, de l’autosatisfaction…), l’investissement du champ visé constituait un facteur déterminant (et en ce domaine l’appartenance sociale est évidemment prépondérante: la connaissance «innée» du champ, de ses rouages, de ses acteurs ne peut pas nuire on s’en doute), a considérablement affecté ma trajectoire.
Ne venant pas moi-même des milieux adéquats, il m’a fallu travailler en conséquence. M’armer contre mon sentiment d’illégitimité en lisant tout, en voyant toujours plus de films, en écoutant toujours plus de disques, en tentant, en quelque sorte, de devenir «incollable». Travailler sans relâche à définir mon projet romanesque, ses tenants, ses aboutissants, son objet même. Le verrouiller. Et «investir» le champ littéraire en l’étudiant sous tous les angles (sociologique, économique, etc.), à défaut de le connaître par «naissance».
Bien sûr, tout cela ne m’a pas empêché de me sentir déplacé dans ce milieu qui pourtant m’a offert une place dont je n’avais jamais osé rêver. Bien sûr rien ne m’aura été épargné des malentendus, complexes, sentiments parfois paranoïaques et souvent réciproques de méfiance ou de condescendance habituellement associés à ce type de position. Bien sûr cela a sans doute déterminé la manière besogneuse qui est la mienne, mon manque de légèreté, ma difficulté à me dérider, aussi bien dans les moments où je dois me frotter au milieu littéraire que dans ma pratique de l’écriture. Mais au regard de ce que cela m’a permis d’accomplir (consacrer ma vie à écrire), ces rigidités personnelles et littéraires, cet inconfort n’ont pas beaucoup d’importance.
Ce qui en a, par contre, c’est la manière dont Bourdieu m’a renseigné, conforté, et continue de le faire quant à la nature même de mon travail, et à son relatif isolement dans un paysage littéraire français marqué par la désertion du majoritaire, du commun, du «social», ou de tout ce qui est supposé l’être (rien de plus français en effet que cette manière de qualifier un roman de «social» – et ce mot est alors étrangement péjoratif – dès lors que ses personnages appartiennent aux classes moyennes ou populaires), et le rejet du facteur «sociologique».
D’abord en me conduisant à dresser ce constat: les écrivains ont déserté le champ des classes moyennes et populaires parce qu’ils n’en viennent pas. Parce qu’ils ne connaissent cette réalité que de loin. Parce qu’on n’écrit jamais que de son propre point de vue (et ce n’est pas une critique que je formule ici. à mon avis mieux vaut écrire sur ce qu’on connaît. C’est le moyen le plus sûr de viser juste. Bourdieu lui-même a montré combien son engagement dans la démarche sociologique répondait à la nécessité de réfléchir à son propre parcours, et comment les objets d’études des chercheurs se définissaient en fonction de leurs origines, de leur trajet, et des obsessions et questionnements associés).
Ainsi, la très grande majorité des écrivains français provenant de la bourgeoisie, c’est à cette même bourgeoisie que s’intéressent la plupart des romans. Le caractère minoritaire des œuvres traitant des classes populaires et moyennes ne traduit jamais que la sous-représentation de ses rejetons dans les rangs des écrivains, selon les mécanismes de reproduction d’ailleurs emblématiques de la pensée bourdieusienne, et l’incapacité des autres à intérioriser des problématiques qui leur sont trop lointaines, par défaut d’expérience.
Ensuite en considérant la méfiance «de principe» qu’entretiennent les catégories dominantes, à l’intérieur même du champ scientifique, à l’égard de la démarche sociologique, nécessairement aride, rebutante, concrète, statistique, objective, et par conséquent moins «noble», moins «élevée» que, par exemple, la philosophie, la littérature, l’histoire ou la psychanalyse, et des problématiques dites «sociales», où l’on se salit sans doute trop les mains, en les exposant au cambouis du concret, du réel, du peuple, de la moyenne, du commun. À ce titre, relisant des entretiens donnés peu avant sa mort, une phrase de Pierre Bourdieu m’a paru particulièrement éclairante:
Quand vous avez parlé de mon travail tout à l’heure, je pense que mon plus grand mérite dans ma trajectoire, ça a été de souvent choisir le moins chic, parce que souvent la vérité est à ce prix.»
On pourrait sans mal l’étendre au champ littéraire. Les classes moyennes, les classes populaires, le majoritaire. Les banlieues, la campagne, le pavillonnaire, les grands ensembles, les lotissements. La vie commune, les lieux communs, le combat ordinaire : le travail, les enfants, le manque d’argent, le surendettement, le chômage, la précarité, la pauvreté, le déclassement, la ségrégation, l’exclusion, l’échec scolaire, les usines, les bureaux, les supermarchés, le Pôle emploi, les hôpitaux, les écoles, les zones commerciales, les zones industrielles, les zones pavillonnaires, et le conformisme de la vie qu’y mène tout un chacun. Tout cela manque tellement de «chic», n’est-ce pas.
Tout cela manque tellement de cette légèreté chère à l’esprit français, ma chère. De cette élégance, propre à une littérature qui s’est toujours rêvée en altitude, pure, éthérée, poétique, dégagée, ironique. À moins de s’en saisir pour dire la répulsion qu’elles inspirent (et combien de fois ai-je entendu des auteurs affirmer leur volonté d’échapper à la réalité commune, de se bâtir contre la médiocrité moyenne, grâce à la littérature), à moins de les regarder d’en haut (et il faudrait s’interroger sur la propension qu’ont certains transfuges à n’être pas les derniers à se livrer à ce jeu, comme pour finir de se fondre, faire oublier les stigmates qui siéent si mal au teint de l’écrivain), comment s’en sortir sans égratignure, sans suspicion, les mains propres et la chemise blanche impeccable?
Expérience
Faites l’expérience. Parlez-en dans un livre, un film, et on vous taxera de misérabilisme, de naturalisme sordide. Évoquez la France moyenne, commune, les gens qui travaillent, vivent comme tout le monde, et on déplorera que vous mettiez en scène des vies étriquées, minuscules, minables. Décrivez ces gens, ces endroits avec un minimum d’empathie et on vous reprochera de vous complaire dans la médiocrité de masse, de glorifier la laideur suburbaine. Descendez à peine plus bas dans l’échelle, faites état de la violence des rapports de classe, de leur permanence même et on qualifiera immédiatement votre roman de populiste, manichéiste, et j’en passe.
Qui pourrait s’y risquer et à quoi bon? Quel bénéfice en tirerait-on? Aucun. Au point d’en arriver à ce qu’un roman ambitionnant de s’emparer de la crise s’intéressera aux traders, à la haute finance, aux dirigeants d’entreprise, aux dominants, plutôt qu’à ceux qui la subissent de plein fouet. Au point qu’un roman prétendant « dire » la société, ne traitera jamais sa réalité moyenne, majoritaire, mais investira invariablement les milieux de l’art, de la publicité, des médias, convoquera mannequins, personnalités télévisuelles, gens de pouvoir, artistes à la mode, comme si vraiment le pays n’était composé que de cela, comme si tout cela pouvait dire quoi que ce soit de sa réalité, de ce qui l’agite et le meut, de ce qu’il devient et de vers où il se dirige.
Vérité
Quel aveuglement pousse ainsi écrivains, éditeurs, et critiques à considérer comme une question spécifique la vie que mène le plus grand nombre, ses difficultés, ses problématiques? Par quel biais en est-on arrivé à penser qu’on pouvait dire la réalité d’une société sans s’attacher à son cœur, majoritaire et silencieux, omniprésent et, paradoxalement, invisible? Mais tout cela ne serait rien si cette défiance pour le social ne se doublait pas ici aussi d’un rejet du «sociologique» tout aussi radical.
En effet, c’est la réalité même des frottements, des comportements, des sentiments, des modes de relation entre les êtres induits par le jeu social et sa conflictualité, sa complexité inhérentes, qui semble ignorée et exclue du champ du roman. Tout s’y passe comme si le poids du déterminisme, des luttes et conflits de classe, les questions liées au travail, au logement, à la précarité, au manque d’argent, à la ségrégation sociale et géographique, etc. étaient vus comme un ensemble de données exogènes, jamais intériorisées, qui ne relèveraient ni de l’intime, ni du quotidien ni de la vérité profonde des êtres qui en sont l’objet.
Comme si tout cela n’avait aucune répercussion sur la psyché, les affects, les manières d’être, de penser, de se construire. Comme si tout cela constituait un ensemble de données moins pertinentes que, par exemple, le facteur «psychologique». Comme si l’on pouvait d’ailleurs scinder à l’intérieur des êtres ce qui relève de l’individuel et ce qui a trait au social. Comme si, ce faisant, on ne courait pas le risque de se crever un œil, quand il s’agirait pourtant de mieux y voir.
Comment prétendre dévoiler une vérité quelconque, individuelle ou collective, en ignorant un pan majeur de ce qui nous gouverne, nous détermine, nous organise et nous meut? Ces questions demeurent à ce jour en suspens. Et l’on s’étonne que dix ans après sa mort, la littérature française se soit si peu emparée de tout ce que Bourdieu a mis à notre disposition pour y répondre. Mais il est encore temps. Bourdieu est mort. Le roman pas encore."

texte initialement publié dans le numéro 45 de la revue «Décapage». Article paru ensuite dans le Nouvelobs du 31-01-13, sous le titre : Pourquoi les romanciers français devraient lire Bourdieu.

/image%2F0986269%2F20150810%2Fob_b6d025_marin-5.JPG)


commentaires